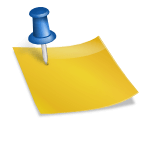Dans une fiction, le temps n’est pas celui des horloges ; il devient une véritable expérience sensorielle et émotionnelle. Le scénariste doit donc concevoir cette temporalité en anticipant à la fois comment elle sera perçue par un lecteur du scénario et vécue éventuellement par un spectateur devant l’écran. Sans même que nous nous en rendions compte, une scène est tout à fait capable de jouer avec notre ressenti du temps par son rythme, ses pauses ou ses variations même minimes lorsqu’une scène se répète pour les besoins de l’intrigue, par exemple.
Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) de Chantal Akerman est extraordinaire pour notre perception du temps. A l’évidence, les 201 minutes du récit sont une durée conséquente, elles servent néanmoins à nous montrer le quotidien de Jeanne en temps réel (ou presque). Là où ailleurs d’autres appelleraient à leur secours l’outil dramatique de l’ellipse, Akerman a délibérément tenté une expérience du temps pour le lecteur/spectateur très proche de celle du personnage.
L’observation minutieuse des détails densifie le temps. Elle nous retient dans le moment. Et dans les gestes pourtant répétitifs de Jeanne, des signes minimes (un geste retenu un peu plus longtemps que d’habitude, un regard suspendu) sont autant de marqueurs temporels. S’il y a bien quelque chose qui caractérise le temps, c’est le changement qu’il opère dans nos vies. Le temps d’Akerman n’est plus extérieur, il nous invite dans l’intimité de Jeanne, dans son propre temps. Et celui-ci nous révèle les non-dits de Jeanne, ses émotions contenues, les tensions qui la déchirent.
Ce qui est d’habitude invisible devient concret. L’absence d’ellipses nous montrent une totalité. L’action n’est plus entachée d’ambiguïtés ou d’incertitudes et cette plénitude nous la rend tangible. Nous n’interprétons pas ; nous n’imaginons pas ni de raisonnons : nous vivons ce que vit Jeanne au moment où elle le vit. Nous avons conscience d’elle immédiatement, aucun obstacle ne vient obstruer notre regard et Sartre parlerait alors de transparence. Akerman a écrit Jeanne avec cette transparence. Ailleurs, un geste nous dirait un état d’esprit, par exemple. Du moins, nous devinerions une émotion cachée sous le geste. Ici, le temps presque réel ne dissimule rien sous lui. Nous vivons l’expérience totale de l’intime chez Jeanne.
Même l’espace avec ses hors-champs est soumis au temps. Il n’est pas un lieu que les personnages investissent. L’espace scénique existe évidemment. Ici, sa matière ne nous est pas donnée par la lumière, les couleurs ou les ombres, les mouvements qui s’y éploient ou les formes qu’il contient, cette matière est une expérience vécue. Le penserions-nous figé ? Nous aurions tort. Car il accompagne la temporalité de Jeanne : le bocal de farine qu’elle prend et remet par exemple. Ce n’est pas un événement isolé et autonome : il fait partie du temps de Jeanne et entraîne avec lui l’espace qui se dissout sous l’action.
Et le hors-champ chez Akerman ne se justifie pas spatialement ; il est certes constitutif de l’espace, et comme celui-ci est temps, le hors-champ l’est aussi.
On a vraiment le sentiment que rien ne nous est caché. Dès lors, nous accédons en confiance à l’intégralité de cet être ; nous savons qu’on ne cherche pas à nous manipuler (ce que ferait une ellipse). La transparence nous fait une promesse de vérité ; ce qu’on nous montre de Jeanne est sincère et cela crée de la proximité. Ailleurs, nous sommes happés par des émotions que nous reconnaissons ou éprouvons plus ou moins. Cela nous prive d’une part de notre liberté : ce n’est même pas volontaire de subir les pleurs d’un personnage. Ici, ce qu’on perçoit ne nous enchaîne pas à l’intention d’un scénariste, d’un metteur en scène ou d’un directeur de la photo. Nous vivons avec Jeanne, nous nous attachons à son corps dans une relation de durée.
Nous sommes tous des individus et en tant que tel, chacun de nous perçoit les choses à sa manière. La durée et la répétition chez Akerman ne seront pas éprouvées à l’identique en chacun de nous. D’aucuns n’en éprouveront que de l’ennui, d’autres seront fascinés, incapables de détacher le regard de l’image et d’autres encore y reconnaîtront la fatigue de leurs routines quotidiennes.
Cet appel à la subjectivité de chacun n’est possible parce qu’Akerman ne nous impose rien. Nous y projetons nos attentes, nos impatiences, notre mémoire. La durée est ce qu’on ressent nous prévient Bergson.
Qu’est-ce que cela signifie vivre ? D’abord, c’est être confronté à l’extérieur et subir ou réagir aux événements qui nous arrivent. Mais c’est aussi, et cela intéresse d’autant plus un scénariste, des sentiments, des pensées, tout un ensemble divers d’expériences intérieures. Le plus compliqué est de saisir avec justesse cette densité intérieure.
Habituellement, la dimension extérieure est omniprésente. Ce sont les actions (conflits, ruptures…) qui donnent son souffle à l’intrigue. Chez Akerman, cependant, l’action est en creux : Jeanne ne réagit pas à de nouvelles situations, elle subit le poids de son quotidien qui pèse tant sur sa vie intérieure. Nous ne pouvons y avoir accès, pas plus que dans la vie réelle, d’ailleurs. Ce sera le dérèglement de la routine chez Jeanne qui agit comme un signe qu’une transformation s’opère en elle. C’est la durée et non la parole ou l’analyse qui fait que, de cette transparence, nous pouvons combler les silences.
Je reprends le concept de nexus. Pour rappel, le nexus est un centre au cœur duquel différentes idées, concepts ou entités se rejoignent et interagissent. Si le temps est un nexus, il n’est plus une série d’événements ou de phénomènes. En lui convergent le présent, le passé et le devenir et, de ces rencontres, nous sommes… ce que nous sommes. Cette existence se constitue aussi de mémoire et d’aspirations ou d’attentes et ainsi, elle gagne en cohérence.
De cette intégration de l’image, du geste, de l’affect et de la mémoire, le nexus nous ouvre à Jeanne, sans nous imposer un quelconque jugement préexistant.
Chez Jeanne, il n’y a pas de conséquences aux multiples causes possibles, le temps comme nexus s’emplit de ses états d’âme qui se désunissent. Cette durée vécue nous rend disponible, libre, aucune émotion ne nous est dictée et alors nous projetons nos propres affects dans ce temps devenu une matière malléable que nous déformons de nos propres attentes, de notre mémoire à nous seuls, pas collective, de nos doutes, de nos silences. Nous partageons avec Jeanne une même temporalité comme si nous identifions notre corps dans le sien.
Le geste ritualisé de Jeanne se lit comme un signe. Habituellement, nous interprétons les signes, nous en tirons une signification qu’il nous faut décoder. Ici, la durée vécue, partagée avec Jeanne, fait que ce signe nous appartient, à nous, lecteur/spectateur. Nous observons cette femme faire la vaisselle, et nous ressentons le même ennui, la même attente peut-être de quelque chose d’autre. Ce n’est pas le geste qui compte, mais le temps qu’il occupe et dans le même coup, le vide qu’il révèle. Et ce vide, il est nôtre aussi : nous le comblons avec notre propre solitude. On ne peut pas mieux partager le même temps.
La subjectivité du temps vécu ne peut mieux s’exprimer ainsi. Bien que l’expérience renvoie quelque chose de différent en chacun de nous, le processus est le même. Analysons davantage : Bergson a amené le concept de temps spatialisé. Qu’est-ce ? C’est un temps ordonné, quantifié, mécanique comme celui des horloges ou bien encore comme la construction d’un récit. Akerman nous libère de cette contrainte de temps. Ici, il n’y a pas d’instants successifs, d’instants qui, même s’ils ne sont pas unis dans une causalité, n’en demeurent pas moins une série de phénomènes. Ici, on éprouve. On ne nous dit pas quoi éprouver, ni quand. On est là : parfois, notre regard soutient l’image, d’autres fois, il s’égare. Nous ne sommes plus des consommateurs d’intrigue, nous communions dans une durée. Et une écriture sans événement n’est pas illégitime. Au contraire, on plonge dans cette eau obscure et on en ressort sous la pression du geste habituel de Jeanne. L’événement n’est pas en soi un drame. La banalité l’est tout autant, si ce n’est plus.
Ainsi, le moindre signe de perturbation dans la routine indique un devenir. Jeanne n’est pas prise dans les rets d’un présent qui l’enserre, elle est bien un projet. Quelque chose d’infime change et une solution de continuité surgit dans la mécanique de la répétition. Dorénavant le temps s’écoule autrement. Chantal Akerman ne dénonce pas la rigidité de nos vies dans laquelle nous nous complaisons. Elle démontre au contraire que le quotidien est poreux et que la force de vie y pénètre et nous en libère. Nous ne sommes pas seulement un lecteur/spectateur de Jeanne. Il nous faut deviner vers quoi tend cette existence inavouée, apparemment immobile.
Avons-nous seulement conscience du temps ? Non le temps dont on dit qu’il file comme un cheval au galop, mais le temps, celui dans lequel on est toujours présent : un temps humain. Pour Akerman, et Ricœur aussi, le récit est précisément ce lieu au sein duquel le temps fait sens. Il nous devient intelligible. Voilà qu’un désordre intérieur se fait jour dans le temps d’un récit. Dès lors, le trouble intime de Jeanne nous devient accessible parce que, justement, le temps du récit nous conte cette désorganisation.
Tantôt l’ellipse est très utile lorsqu’une scène exige d’être condensée, tantôt la durée réelle de l’action s’avère juste car le lecteur/spectateur, pris dans cette action, anticipe ce qu’il se passera. L’espace scénique sera soigneusement pensé afin que chaque détail participe de la durée de l’action. Non seulement, cet espace tire sa structure du temps ; il influence aussi notre perception de celui-ci. Chaque détail, de la table de la cuisine à la lampe de chevet, ne cherche pas à figer l’action dans un cadre, mais à confondre le corps de Jeanne dans son environnement : un corps lent qui se meut dans des habitudes.
Chaque distance entre Jeanne et ses objets, chacun de ses gestes comme ouvrir un tiroir ou la boite à sucre, sont marqués par un retard ou un allongement. C’est un changement d’état psychologique qui se montre dans la durée. Un retard dans un geste qu’on a pourtant l’habitude de faire (on est interrompu, on hésite ou bien encore on rencontre une difficulté inattendue) provoque une dilatation du temps (et même l’espace occupé par l’action) parce que sa durée est prolongée. Et dans le sens contraire, un mouvement plus rapide que d’habitude (comme une sorte d’urgence) compresse et le temps et l’espace.
L’espace scénique, à l’intérieur de ses limites, joue avec la durée. Le personnage ressent cette durée et nous aussi. Est-il confiné que la matière s’appesantit et le temps se dilate sous la pression. Une succession rapide dans un grand espace paraît lente ; en revanche, un mouvement lent dans un espace restreint semble bien plus rapide qu’il n’est en réalité.
Une métaphore met à notre portée un état intérieur : lorsqu’un espace est chaotique, l’état d’esprit l’est aussi. La subjectivité de Jeanne nous est ainsi accessible par la durée de ses gestes à l’intérieur de l’espace scénique qui se continue aussi dans le hors champ. Nous voulons que notre lecteur/spectateur ressente l’action : s’il me faut insister sur la relation de deux personnages, plutôt que de les faire s’enlacer (se battre ou s’embrasser), je peux tout aussi bien et peut-être avec plus d’efficacité prolonger la scène dans sa durée réelle afin de laisser aux personnages le temps de construire cette relation. L’invisible se montre aussi dans la durée.
Et chez Jeanne, ce sont ces légères variations dans la durée de ses routines qui marquent son lent délitement intérieur.